Par Eugène Ebodé*
Universitaire d’origine camerounaise, écrivain à succès de chez Gallimard, dont le nouveau roman « Habiller le ciel », enregistre une critique positive. Administrateur de la Chaire des Littératures et des Arts africains de l’Académie du Royaume du Maroc, créée par le Secrétaire perpétuel, Abdeljalil Lahjomri, pour promouvoir le patrimoine culturel, historique et artistique africain par la recherche, il est de retour dans son continent natal après avoir passé une quarantaine d’années en Europe. Un retour sur fond de souvenirs qu’il a bien accepté de partager chaque premier vendredi du mois en copublication Newsafrica24 et Quid.ma. Dans ce cinquième épisode, il se souvient de sa lutte pour réussir ses études, notamment le concours d’entrée au Celsa, une école de communication rattachée à l’Université de Paris-Sorbonne, la préparation des diplômes à vocation professionnelle (DESS) et doctorale (DEA), sans oublier la rencontre avec le sociologue Pierre Bourdieu, le discours du président français François Mitterrand à la Baule, en 1990, et la réponse de Sa Majesté le Roi Hassan II du Maroc.

Pourquoi ai-je eu, après l’obtention des diplômes, le sentiment que nous avions, durant nos années d’études, ferré des joies infidèles et dansé sur des tuiles éphémères ?
À la sortie de l’Institut d’Études politiques, pendant que mes condisciples filaient en Prépa ENA ou passaient les concours administratifs dans les IRA (Instituts régionaux d’Administration) ou encore, par goût pour les Affaires étrangères, couraient s’inscrire aux Langues orientales, je ne les suivis pas, malgré leur insistance. Ils ne comprenaient pas mes « Pas pour moi, tout ça ! » Ils ignoraient simplement que je ne pouvais passer un concours réservé aux nationaux, car je n’avais pas la nationalité française. Je rechignais à le leur dire. Le Cameroun n’admet pas la double nationalité. On perdait donc celle-ci en acquérant toute autre. Nous étions nombreux, à l’étranger, à croire que nous portions en nous un pays singulier et que notre attachement à celui-ci ne souffrait pas l’adoption d’une autre tunique nationale. Cela valait abandon des siens. Et puis, il y avait en moi une fierté de conserver mon passeport vert pomme.
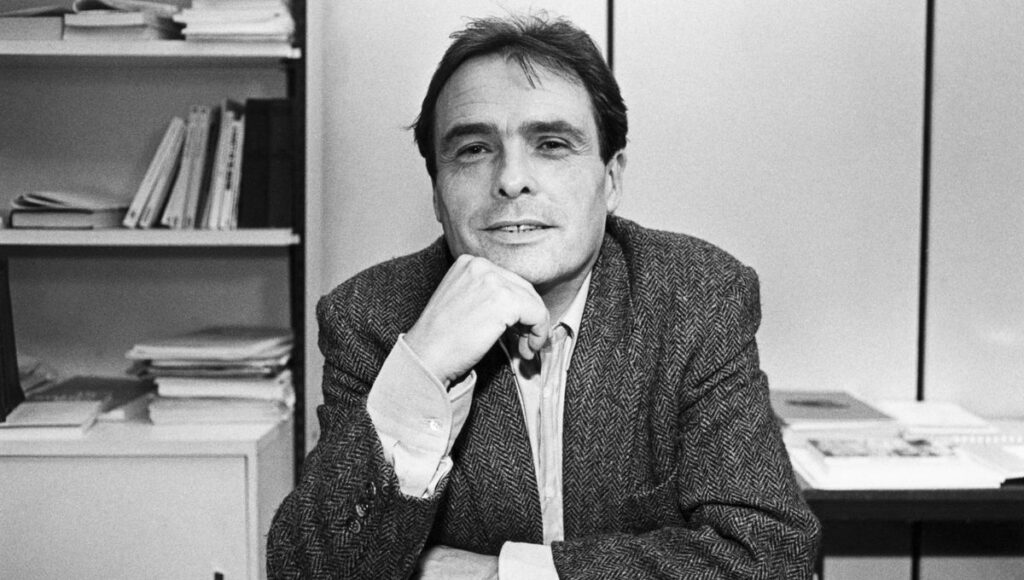
Comme j’étais plein d’énergie et que maman attendait des diplômes pour continuer à tapisser les murs de la maison, je me présentai au concours d’entrée au Celsa, une École de communication rattachée à l’Université Paris IV-Sorbonne et dont l’accès n’était pas réservé aux seuls nationaux. Je fus reçu aux deux examens qu’elle proposait : l’accès au DESS (à vocation professionnelle) et au DEA (études doctorales). J’aimais la compétition et j’avoue qu’elle me galvanisait. Pour les anciens de Sciences Po, la compétition servait aussi à valider, croyions-nous, l’excellence de notre formation. Le rite de la sélection nous renforçait dans l’idée que le mérite républicain fonctionnait à travers ce tamis et quiconque s’y aventurait, testait la solidité du nouvel ordre social républicain où la distribution des postes ne semblait plus dépendre de la filiation et de la lutte des classes, mais de la lutte plus feutrée des places. L’origine ethnique, régionale et confessionnelle d’un individu, voire le poids du capital financier détenu par les parents, ne semblait pas compter. L’anonymat des copies entretenait la certitude que seul le mérite délivré par l’école était le mode privilégié d’ascension sociale. Pierre Bourdieu (1930-2002) et Jean-Claude Passeron (1930) n’y croyaient que fort modérément, et la sociologie contestait, à coups de statistiques et de courbes macro comme micro-économiques, la grande disparité entre revenus du capital et revenus du travail. Les trajectoires restaient harassantes pour les membres des catégories sociales aux revenus modestes pour aspirer à mobiliser un capital culturel conséquent. Il était difficile pour les enfants de personnes modestes et l’était davantage pour ceux des plus démunis de songer, statistiques en main, à bénéficier du même stock de connaissances et de parchemins que ceux des descendants de riches. Quand bien même l’acquisition des diplômes augmentait partout dans la société et que le niveau de scolarisation s’élevait, les personnes issues de classes sociales modestes devaient aussi user de stratégies épuisantes pour percer le plafond de verre. L’habitus, ce concept de Pierre Bourdieu, renvoyait aux habitudes et façons d’être d’un groupe social, et indiquait combien restaient reconnaissables les membres d’un groupe donné, soit par le mode vestimentaire ou par le comportement. La massification de l’école était en partie destinée à diffuser des codes communs, cependant la proclamation qui en découlait urbi et orbi et qui voulait que l’ascension sociale par l’école fût garantie ressemblait fort à un sésame aux allures de propagande. Les femmes mariées avaient, du fait des accouchements, des carrières en dents de scie et des rémunérations en dessous de celles de leurs collègues masculins. Chacun pouvait aussi observer, arguait Bourdieu, que L’Amour de l’art (Pierre Bourdieu et Alain Darbel, 1966) dépendait du niveau d’instruction, et donc, grosso modo, du niveau social des parents. Par conséquent, la fréquentation des musées, par exemple, devenait plus soutenue si le milieu familial était élevé et sensible aux goûts esthétiques, par inclination personnelle, par atavisme, par la classe sociale ou par volonté de distinction. La réussite dans l’enseignement supérieur était-elle liée au niveau d’études des parents ? Oui, dans ces années quatre-vingt qui s’achevaient, et le constat demeure toujours vrai au XXIe siècle. Une étude de Olga Kasatkina, Laurent Lima et Nadia Nakhili, publiée dans Vie sociale en 2020[1], démontre que les étudiants de la première génération, autrement dit ceux dont les parents ne sont pas allés à l’université, ont, en France en particulier (ce qui n’est pas forcément le cas aux États-Unis, au Canada, voire en Belgique), un taux d’échec scolaire plus élevé que celui des étudiants dont les parents ont fréquenté l’enseignement supérieur. Tout récit méritocratique doit donc tenir compte de ces paramètres structurels. L’intuition sociologique, comme l’analyse « bourdivine » de 1964, lorsqu’il publia Les héritiers, reste recevable. Ce texte qu’a commenté l’économiste Thomas Picketty[2], pour remettre en perspective la question des inégalités en France, montre que les modes de transmission, non seulement de capitaux symboliques, mais de statuts, se poursuivent, sous la République française supposément égalitaire, fraternelle et sociale. Les mécanismes de fragmentation de la société reposaient essentiellement sur le fait, rappelle Thomas Picketty, qu’en 1964, « moins de 1 % des fils d’ouvriers agricoles deviennent étudiants, contre 70 % des fils d’industriels et 80 % des fils des professions libérales. Un système explicitement ségrégationniste, comme celui qui disparaît aux États-Unis en cette même année 1964, ne ferait guère mieux. »
Si le pourcentage des étudiants issus de catégories sociales aux capitaux culturel et financier faibles s’est amélioré du fait des politiques publiques incitatives (bourses, multiplication des filières, formation des salariés), les difficultés sociales empêchant certains étudiants de s’inscrire en Master sont grandes. Est tout aussi grand le déficit de passerelles structurelles pour conduire l’action publique en France vers l’équité, à défaut de réaliser l’égalité sociale proclamée. La juste répartition et allocation de ressources issues du produit national brut demeure le nœud gordien des politiques acquises désormais au « moins d’État ». Reste donc à la disposition des individus les plus décidés, pour sortir du déterminisme social, la farouche volonté individuelle de grimper l’échelle des considérations et des statuts ou l’accès improbable à la Noblesse d’État (Pierre Bourdieu, 1989).
Étudiants, nous avions sans réserve approuvée cette analyse, et il n’avait jamais été nécessaire que le professeur Bruno Étienne tempêtât et montât sur son bureau pour nous convaincre. Nous pouvions, nous-mêmes, à Sciences Po, mesurer le faible pourcentage de fils et filles d’ouvriers à l’Institut : moins de 10 %. L’échec en 1re année les frappait plus que les autres étudiants de catégories sociales plus aisées : les fameuses CSP+. Certes, quelques « bourges » mordaient aussi la poussière, mais ils étaient une poignée. Si j’évoque la mémoire de Pierre Bourdieu, c’est parce que me revient notre rencontre à Aix-en-Provence.
Le célèbre sociologue était alors venu à Sciences Po pour nous présenter son petit ouvrage, Leçon sur la leçon, tiré de son discours inaugural au Collège de France en 1982. Il avait rompu avec des rites académiques (notamment les références à ses pairs) et la pompe qui accompagne généralement cet exercice. Je l’écoutai religieusement nous raconter les prolégomènes de sa pensée, comme tous mes camarades et condisciples qui avaient pris d’assaut l’amphithéâtre. Puis vint le moment des questions de l’auditoire. Je levai la main. On me tendit un micro. Je décidai de bousculer notre pape de la sociologie :
- Professeur, votre discipline, la sociologie, entend éclairer le fonctionnement de la société qu’elle observe. Mon Dieu, pour quelle raison utilisez-vous un langage à ce point complexe et compliqué ? Il ne fait en définitive que voiler davantage ce que vous avez la prétention de clarifier !
Il ne sourit ni ne broncha. Après un silence, il assuma la chose :
- Oui, le langage du sociologue est complexe parce qu’il restitue la complexité même de la société.
Il y eut d’autres questions et des réponses. Tranquillement, le professeur du Collège de France argumenta, déployant un large éventail discursif articulé autour des faits, de l’objectivation, du cortège de données que Big Data et ses ordinateurs peuvent désormais traiter. Nous appréciâmes l’érudition du philosophe reconverti en sociologue avec sa batterie de chiffres, d’enquêtes de terrain, de construction d’échantillons, de classes d’âge, de genre (homme/femme), de lieux, de binarité (ville/campagne, monde urbain/monde rural) et de pourcentages. Il s’exprimait sur un ton presque monocorde, débarrassé de tout effet oratoire. On aurait dit que nous n’étions pas là, qu’il soliloquait. Il nous réintégrait par saccades, brèves et sèches. Vous me comprenez, n’est-ce pas ? La leçon sur les leçons nous allait bien. Il y eut le rite des applaudissements à la fin. Puis, nous sautâmes sur le divin sociologue, le livre à la main. Il était à la portée de nos maigres bourses. Le professeur s’interrompit avant ma dédicace :
- Votre question m’a plu. Vous êtes étudiant à Sciences Po ?
- C’est cela. En dernière année.
- Quel est votre sujet de mémoire ?
- Les moyens sociaux de la communication horizontale.
- Le champ ?
- Marseille. Les quartiers nord, précisément Le Petit séminaire. J’y ai déjà noté la disparition régulière des bistrots.
- Ces lieux où la parole circule librement. Cela m’intéresse. Envoyez-moi un résumé de votre sujet. Voici mon adresse. Je vous répondrai. »
Il tint parole. Il m’adressa une lettre élogieuse sur mes recherches, mentionnant « l’homothétie entre les membres des diverses communautés du Petit séminaire à Marseille et les aspirations à une citoyenneté plus vivante ». Il m’invita aussi à participer à un groupe de recherche restreint. Il le réunissait tous les jeudis matin à l’EHESS, boulevard Raspail, à Paris…
Les places étaient chères et ce fut un privilège de bénéficier d’une telle convocation. Ai-je regretté de n’avoir pas poursuivi les travaux avec ce groupe ? Je ne pouvais « monter » à Paris quand bon me semblait. J’y avais été le seul étudiant au milieu d’enseignants-chercheurs déjà bardés de diplômes et de techniques qualitatives ou quantitatives. Ils avaient accueilli avec bienveillance (et indulgence) ma communication. J’ignorais que je ne reverrais plus jamais l’auteur de La Misère du monde (1993), un livre collectif sur les décrochages sociaux qui sonnaient la désillusion des socialistes au pouvoir en France et le commencement de la fin du Welfare state. Le chômage massif et persistant déprimait la société. La désindustrialisation s’accélérait au plus grand bonheur de la Chine, nouvel atelier du monde qui aimantait à son profit les délocalisations encensées par la mondialisation. Le grand décentrement s’annonçait. Durant les années 90, en Afrique, allaient aussi se tenir les conférences nationales, que la France déboussolée mit en branle, sous François Mitterrand (1916-1996), à la Baule (Discours du 20 juin 1990). Le Roi Hassan II (1929-1999) lui répondit avec autorité et maestria (je cite de mémoire) : « Place à l’Afrique, décidant par elle-même et pour elle-même ! »
* Administrateur de la Chaire des littératures et des arts africains à l’Académie du Royaume du Maroc ; Professeur en diplomatie culturelle à l’Université Lansana Conté (Conakry) ; Chroniqueur littéraire au Courrier de Genève.
[1] KASATKINA Olga, LIMA Laurent, NAKHILI Nadia, « La réussite académique à l’université dépend-elle des études supérieures de ses parents ? », Vie sociale, 2020/1-2 (n° 29-30), p. 55-71. DOI : 10.3917/vsoc.201.0055. URL : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2020-1-page-55.htm
[2] Sources :https://www.lemonde.fr/blog/piketty/2018/02/13/1964-les-heritiers/



